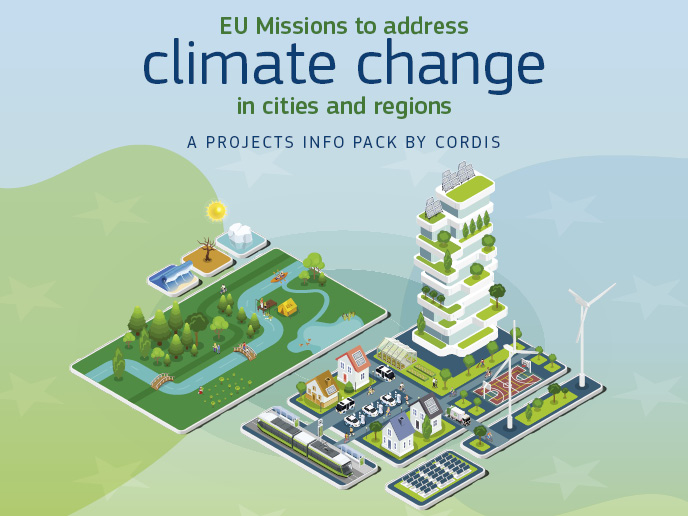Les hausses de température sont liées aux émissions de CO2 par la roche
La température de surface de la Terre est influencée par les concentrations atmosphériques de gaz tels que le CO2, qui contribuent à ce que l’on appelle l’effet de serre. Depuis la révolution industrielle, les concentrations de CO2 ont augmenté de façon spectaculaire, en grande partie à cause de la combustion de combustibles fossiles. Il est essentiel d’atténuer ces émissions pour maîtriser la hausse des températures. Pour évaluer nos progrès, les scientifiques doivent mesurer avec précision les émissions de CO2 et identifier les sources de fuite de CO2. Cela signifie qu’il faut prendre en compte non seulement les émissions d’origine humaine, mais aussi les sources naturelles de fuite de CO2.
Cycle naturel du carbone
Le projet ROC-CO2(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a été lancé pour combler une lacune dans notre compréhension du cycle naturel du carbone. Les scientifiques savent que lorsque les roches se décomposent, le CO2 peut être à la fois libéré et absorbé, en raison notamment de l’oxydation du carbone organique qu’elles contiennent. Il s’agit d’un processus connu sous le nom d’altération chimique. À ce jour, les scientifiques n’ont toutefois pas été en mesure de mesurer avec précision ou de comprendre pleinement les mécanismes de ce processus. Pour mieux appréhender l’altération chimique, le projet ROC-CO2, soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), a mis au point de nouvelles méthodes d’analyse pionnières.
Mesurer les émissions de CO2
«Mesurer la libération de CO2 par la roche est très difficile», explique le coordinateur du projet ROC-CO2, Robert Hilton, de l’université d’Oxford(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au Royaume-Uni. «Nous savons cependant que lorsque les roches se décomposent, toute une série d’éléments se retrouve dans les rivières et les lacs voisins.» L’un de ces éléments est le rhénium, qui, selon Robert Hilton, pourrait servir de mesure indirecte du carbone. En prélevant des échantillons de rivière et en analysant la teneur en rhénium, lui et son équipe ont pu dresser un tableau de la dégradation des roches dans une zone donnée et mesurer la vitesse à laquelle ce processus se déroule. Deuxièmement, Robert Hilton et son équipe ont cherché à mesurer directement les niveaux d’émission et d’absorption de CO2 dus à l’altération des roches. «Nous avons fixé des capteurs de CO2 sur des roches de notre site en France et nous avons observé comment les roches "respirent"», explique Robert Hilton. «C’était beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, car nous devions être sûrs que nous ne mesurions pas les émissions de CO2 de l’atmosphère, ou des racines des plantes.» Pour cela, l’équipe a prélevé des échantillons de gaz et mesuré les niveaux de radiocarbone. Étant donné que la demi-vie des isotopes du radiocarbone(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) est de plusieurs milliers d’années, une lecture négative signifiait que l’équipe pouvait être sûre que le CO2 provenait d’une source non vivante, c’est-à-dire d’une roche.
Impact sur le climat
Après quelques années, le projet a pu conclure que la quantité de CO2 libérée par l’altération des roches augmentait en fait avec la température. En hiver, les émissions de CO2 du site d’essai ont diminué; en été, elles ont augmenté. «Cela laisse entendre que davantage de CO2 sera libéré à mesure que le climat se réchauffe», ajoute Robert Hilton. «Si cela se produit au-delà de notre site d’essai, alors certains aspects de notre façon d’envisager le cycle du carbone devront changer.» Pour Robert Hilton, les résultats du projet ont ouvert de nouvelles voies de recherche. «Nous ne pouvons pas choisir où et quand le cycle naturel du carbone va libérer du CO2 dans l’atmosphère», explique-t-il. Par exemple, il existe des roches sédimentaires sous le permafrost. «Celles-ci commenceront-elles à rejeter du CO2 si le permafrost fond? C’est quelque chose que nous devons découvrir.» Les méthodes de ROC-CO2 sont désormais adoptées par d’autres chercheurs dans le monde. Leurs résultats permettront de mieux comprendre l’incidence probable des flux de CO2 provenant de la décomposition des roches sur le climat, sur une échelle de temps allant d’une saison à des milliers d’années.