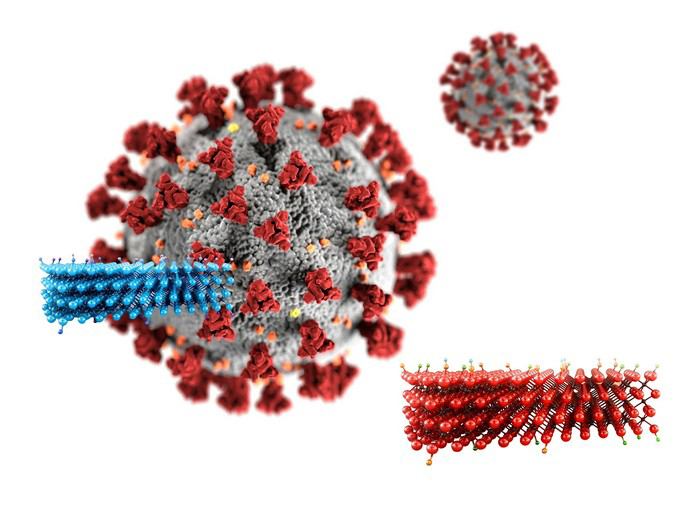De nouveaux tests chimiques pourraient contribuer à préserver la santé du fœtus
Les perturbateurs endocriniens (PE) sont des substances chimiques qui peuvent interférer négativement avec les systèmes hormonaux en imitant les hormones ou en bloquant leur activité normale. Ils sont généralement présents dans les plastiques, les pesticides et les retardateurs de flamme, s’infiltrent dans l’environnement et la chaîne alimentaire, et s’accumulent dans le corps humain. Un domaine d’étude essentiel est la manière dont les PE peuvent entraver le développement hormonodépendant dès la vie in utero, ainsi que pendant les périodes sensibles telles que le développement néonatal.
Des produits chimiques présentant les caractéristiques d’un PE
Le projet ATHENA(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE, s’est concentré sur ce domaine, et en particulier sur la production et l’apport local en hormones thyroïdiennes. Elles jouent notamment un rôle crucial dans la régulation du métabolisme et de la croissance du corps. Au cours des premières semaines de gestation, le fœtus est incapable de produire des hormones thyroïdiennes et dépend de l’apport maternel. Nous savons que les PE présents dans le système maternel peuvent diminuer l’hormone thyroïdienne en circulation, modifiant ainsi les niveaux qui parviennent au fœtus. «L’apport d’hormones thyroïdiennes maternelles au cerveau du fœtus via la barrière placentaire revêt une importance capitale, en particulier au cours du premier trimestre», explique Martin Scholze, membre du projet ATHENA, de l’université Brunel(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), au Royaume-Uni. «La perturbation de ce processus par les PE peut entraîner des déficits irréversibles tout au long de la vie adulte.» Il existe encore des lacunes dans les connaissances en ce qui concerne les mécanismes moléculaires et les composants protéiques fonctionnels impliqués dans ce processus. Le projet ATHENA entendait y remédier en concevant de nouveaux modèles expérimentaux et de nouvelles méthodes d’essai. «Une approche combinée impliquant des méthodes in silico, in vitro, expérimentales ex vivo chez l’animal et épidémiologiques chez l’homme a été mise au point», explique Josef Köhrle, membre du projet ATHENA, de l’hôpital universitaire de la Charité(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) à Berlin, en Allemagne. «Ces approches ont été validées et appliquées pour identifier les scénarios d’exposition aux PE.» Ce travail a permis à l’équipe du projet de déterminer de nouvelles méthodes potentielles pour identifier des produits chimiques présentant des caractéristiques de PE susceptibles d’avoir des effets néfastes sur le développement du système hormonal thyroïdien.
Une stratégie d’essai en plusieurs étapes pour identifier les PE
Le projet a contribué à réaliser des progrès importants dans l’identification de l’exposition aux PE ayant une incidence sur l’homme, en mettant l’accent sur la santé materno-fœtale liée aux hormones thyroïdiennes pendant la grossesse. Une stratégie d’essai en plusieurs étapes a été mise au point et proposée pour identifier les PE affectant le système hormonal thyroïdien materno-fœtal au cours du développement. Afin de procéder au criblage de grandes bibliothèques de composés, l’équipe du projet a aussi établi des relations quantitatives structure-activité (QSAR pour «quantitative structure-activity relationships»), à savoir des modèles mathématiques utilisés pour prédire les propriétés biologiques des composés à partir d’informations sur leur structure chimique. «Nous avons également pu montrer que l’amitrole, un pesticide encore présent dans notre environnement, est un PE susceptible de provoquer des malformations de la structure cérébrale, ainsi que des troubles du comportement chez la progéniture des rats après exposition de la mère pendant la grossesse et l’allaitement», ajoute Josef Köhrle.
Prévoir et identifier de potentiels PE
Les méthodes et techniques mises au point dans le cadre d’ATHENA, ainsi que les connaissances acquises, favoriseront l’élaboration de tests normalisés permettant de prévoir et d’identifier de potentiels PE susceptibles d’affecter le système hormonal thyroïdien au cours de la grossesse. «Ces méthodes d’essai vont encore faire l’objet d’améliorations en vue d’être acceptées par les autorités réglementaires», explique Martin Scholze. De plus, les données accumulées ont apporté un nouvel éclairage sur le développement du cerveau fœtal dépendant des hormones thyroïdiennes chez de nombreuses espèces de vertébrés, qui dépendent toutes essentiellement d’un apport local adéquat d’hormones thyroïdiennes. Ces résultats contribuent à souligner les conséquences d’une carence en hormones thyroïdiennes chez la mère pour le développement du cerveau en raison des PE.