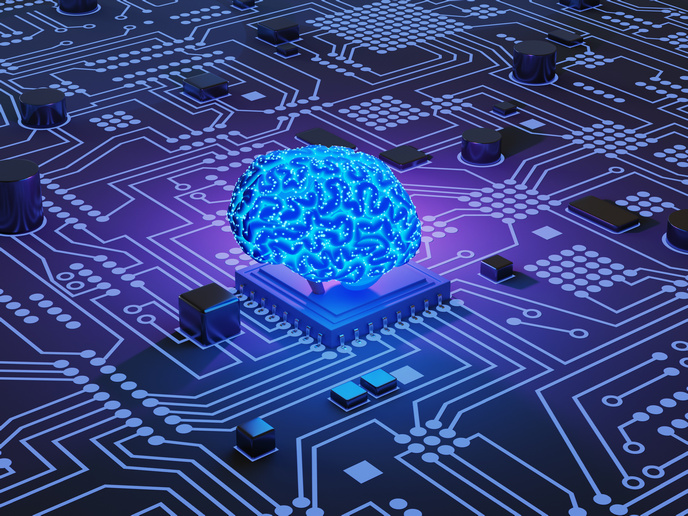Le cerveau sur puce comme outil de modélisation préclinique
La démence, terme qui recouvre une myriade de troubles entraînant un déclin des fonctions cérébrales, touche environ 10 millions de personnes rien qu’en Europe, un chiffre qui devrait doubler d’ici la fin de la décennie. Pourtant, malgré des dizaines d’années de recherche, le traitement efficace de ces maladies reste insaisissable. «La complexité du cerveau rend extrêmement difficile la prédiction et la recherche de nouvelles solutions médicales», explique Manuel Bañobre, chercheur au Laboratoire international ibérique de nanotechnologie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Par conséquent, la culture cellulaire en 2D et les modèles animaux sont devenus l’étalon-or pour le développement de médicaments et la recherche. Cependant, outre les préoccupations éthiques, ces modèles ne peuvent pas reproduire parfaitement les paramètres physiologiques et la complexité du cerveau. Les dispositifs de type «cerveau sur puce» (BoC pour «brain-on-a-chip») viennent combler cette lacune technologique. «En découplant le cerveau en différentes structures cellulaires tout en maintenant leurs interconnexions, les dispositifs BoC offrent un outil prometteur et convivial pour la réalisation de modèles précliniques», ajoute Manuel Bañobre. Le projet BrainChip4MED, financé par l’UE, permet de tirer parti de cette promesse.
Modélisation de la barrière hémato-encéphalique
Le projet, qui a bénéficié du soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (MSCA), s’est concentré sur la modélisation de la barrière hémato-encéphalique (BHE). «La BHE a évolué comme un système de protection supplémentaire des vaisseaux sanguins, fonctionnant comme un gardien qui empêche les toxines et autres substances nocives d’atteindre le cerveau», explique Raquel Rodrigues, la chercheuse MSCA qui a participé au projet. Comme le remarque Manuel Bañobre, l’efficacité de la BHE repose sur la conformation physiologique des cellules endothéliales vasculaires. Celles-ci forment des jonctions serrées et adhésives, créant une barrière semi-perméable sans fenestration qui limite la libre diffusion et l’échange rapide de molécules entre le sang et le cerveau. «La BHE protectrice est également l’un des principaux obstacles à la création de médicaments efficaces capables de traverser cette barrière sanguine et de cibler les cellules cérébrales», note Manuel Bañobre, coordinateur du projet.
Faire progresser les modèles de barrière hémato-encéphalique
Pour relever ce défi, les chercheurs ont mis au point une bio-membrane innovante basée sur la matrice extracellulaire native du cerveau. Élaborée à l’aide d’une nouvelle membrane pro-angiogénique à base de gélatine capable de charger et de libérer les facteurs de croissance nécessaires à la vascularisation des neurones, la bio-membrane reproduit fidèlement les propriétés mécaniques, l’hydratation et les signaux d’adhésion du cerveau. Le résultat de ce travail est une méthode simple, rapide et non toxique pour produire une bio-membrane BHE précise capable de maintenir et de générer des conditions idéales pour la propagation, l’adhésion et la formation de jonctions serrées des cellules endothéliales vasculaires pendant plusieurs jours. «Cela représente une avancée significative dans l’état actuel des connaissances en matière de développement de modèles de BHE», ajoute Manuel Bañobre.
Un grand pas vers de meilleurs soins de santé pour tous
En fin de compte, le projet a permis de concevoir une plateforme nanomédicale qui permet de cribler des formulations pertinentes pour l’administration de traitements ciblant le cerveau. L’équipe a également mis au point une nouvelle stratégie de biodétection optique pour surveiller les caractéristiques de la maladie d’Alzheimer au cours des essais précliniques. «Il s’agit d’un premier pas important vers la mise au point d’un outil préclinique susceptible d’orienter le pronostic et de favoriser des décisions thérapeutiques plus efficaces pour les médicaments ou autres systèmes nanothérapeutiques conçus pour les maladies neurodégénératives, ce qui permettra d’améliorer les soins de santé et le bien-être de tous», conclut Raquel Rodrigues. Raquel Rodrigues continue de travailler au développement du prototype BrainChip4MED, en mettant l’accent sur l’intégration de systèmes de biodétection pour le criblage continu et en temps réel de médicaments et de nanocarriers mis au point pour traiter les maladies neurodégénératives.