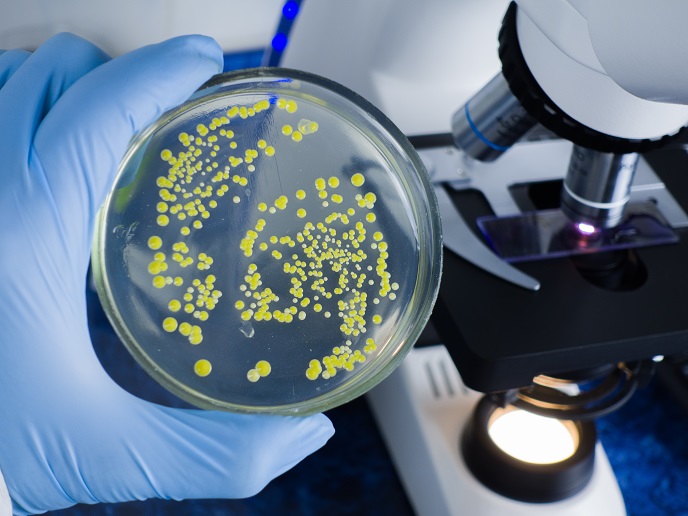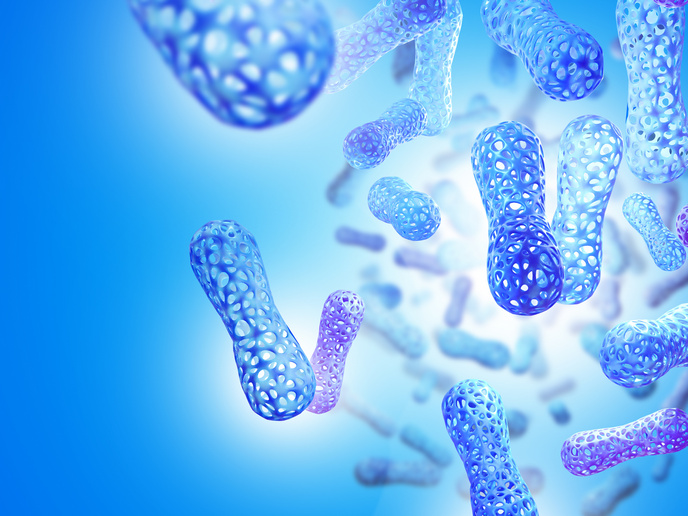L’évolution microbienne fournit des indices sur l’histoire de la vie
Les microbes, qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et la santé humaine, ont évolué au fil du temps pour prospérer. Les considérables progrès réalisés dans les techniques de séquençage permettent aujourd’hui d’acquérir une multitude de données sur la diversité de la vie microbienne, et de mieux comprendre leur fonctionnement et leur évolution. «Une question fondamentale consiste à comprendre comment ils produisent et conservent leur énergie», explique la coordinatrice du projet EvolPhysiol, Filipa Sousa(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), de l’université de Vienne(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). «Si les ordinateurs fonctionnent à l’électricité, les êtres vivants utilisent l’ATP (adénosine triphosphate, la principale molécule porteuse d’énergie dans les cellules).» L’humain produit de l’ATP en respirant de l’oxygène. Certains microbes ont cependant développé des mécanismes de production d’ATP non seulement à partir de l’oxygène, mais aussi à partir d’autres sources telles que le soufre et l’azote.
Pénétrer les microbes
Le projet EvolPhysiol, soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), s’était fixé pour objectif d’étudier la manière dont les microbes ont appris à produire de l’ATP et comment ce processus a évolué au fil du temps. Le projet a plus particulièrement concentré ses recherches sur les archées et les bactéries, deux groupes de micro-organismes unicellulaires dont on sait qu’ils sont omniprésents. «Notre principal objectif était d’obtenir des informations sur ces microbes», confie Filipa Sousa. «Nous voulions comprendre la diversité globale des microbes aujourd’hui et remonter dans le temps.» Le projet s’appuie sur le fait que la biologie est très modulaire. «À différents niveaux, la vie est souvent constituée de blocs de construction, tels des Lego, ajoute Filipa Sousa. «Les protéines, par exemple, peuvent se réorganiser pour construire différentes choses. Cela diversifie les fonctions et permet aux organismes de gérer différents composés.» L’équipe du projet a également «regardé» à l’intérieur des protéines pour identifier les cofacteurs que réutilisent fréquemment les organismes. «Cela signifie que lorsqu’ils évoluent, ils ne doivent pas tout inventer de zéro», explique Filipa Sousa.
Grandes bases de données génomiques et séquences
Le projet portait sur des milliers de génomes. De grandes bases de données génomiques ont été filtrées pour vérifier la qualité des gènes et leurs séquences ont été comparées pour identifier des protéines. «Le plus amusant a été d’essayer de donner un sens à toutes ces données, tout en tenant compte de considérations biologiques et géologiques», explique Filipa Sousa. Ces travaux ont donné des résultats très inattendus, notamment en ce qui concerne le cycle du soufre. Le consensus général était que l’archéoglobus devait avoir acquis cette fonctionnalité via des bactéries. «Alors que nous avons déterminé qu’une enzyme clé impliquée dans le cycle du soufre provenait probablement d’une bactérie, le reste de la voie a été le résultat d’un remplacement synonyme (un changement dans la séquence d’ADN dans lequel la séquence d’acides aminés produite n’est pas modifiée)», explique Filipa Sousa.
Identifier de nouvelles applications biotechnologiques
Compte tenu de la quantité de données générées, l’équipe du projet n’a pas pu tout examiner, et plusieurs aspects du projet, tels que la diversité microbienne, sont en cours d’étude. «Je souhaite désormais poursuivre notre quête pour voir l’évolution de ces éléments constitutifs», déclare Filipa Sousa. «Je pense qu’il est propre à notre nature humaine de vouloir savoir d’où nous venons.» Filipa Sousa rappelle que notre planète, dont l’âge est estimé à environ 4,5 milliards d’années, était autrefois peuplée uniquement de bactéries archéennes. Comprendre comment ces microbes ont évolué en même temps que l’environnement peut nous en apprendre beaucoup sur notre passé lointain, et peut-être aussi profiter à notre avenir grâce à l’identification de nouvelles applications biotechnologiques. «Plus nous en apprenons à leur sujet, plus nous pouvons les utiliser en notre faveur», ajoute-t-elle.