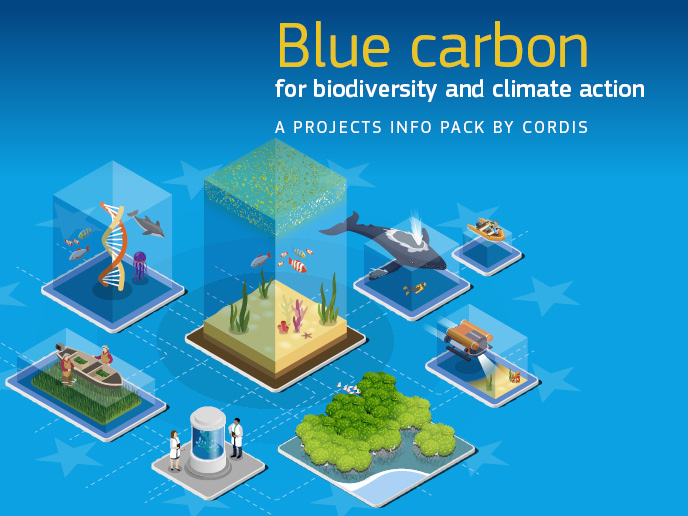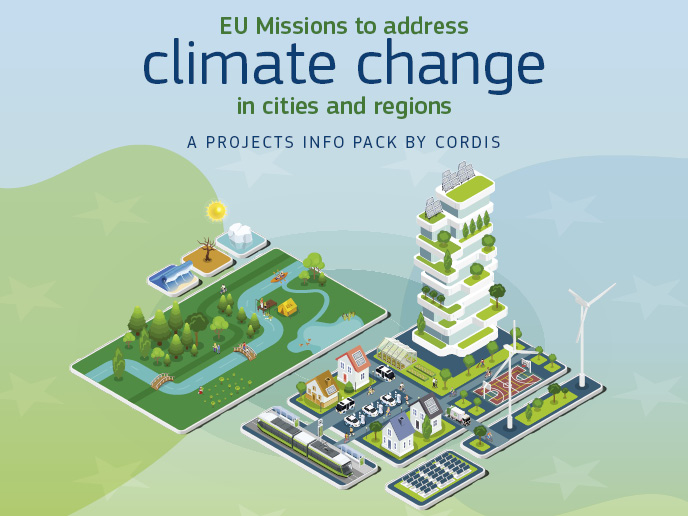Les bancs d’algues sont des points de concentration de la pollution plastique
Les débris de plastique et les déchets marins font malheureusement partie de l’écosystème côtier au même titre que le sable et les algues. Une promenade le long de la plage peut laisser penser que les algues marines piègent le plastique, l’empêchant ainsi de polluer davantage l’environnement. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Selon le projet SCRAP financé par l’UE, les débris de plastique sont effectivement piégés dans les lits d’algues, mais ce n’est qu’une partie du phénomène. Des chercheurs du projet ont prélevé des échantillons de diverses espèces d’algues marines et du sable qui les recouvre, et ont retiré toutes les particules de plastique coincées dans les frondes. En comparant ces échantillons avec du sable vierge situé à proximité, ils ont pu déterminer si les algues capturaient les déchets ou si elles contribuaient à les déplacer dans les sédiments. «La comparaison entre le sable couvert d’algues et le sable vierge nous a permis de déterminer si les algues agissent davantage comme un piège collant ou comme une voie de transport des plastiques dans les sédiments», explique Hoi Shing Lo, chercheur à l’université de Stockholm(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), partenaire coordinateur du projet. Ils ont découvert que les bancs d’algues constituent des points de concentration de la pollution plastique. «Les plastiques s’accumulent dans ces forêts sous-marines, se retrouvent piégés entre les frondes et se déposent dans le sable», ajoute Hoi Shing Lo.
Les microplastiques amplifient le problème
C’est là que les choses deviennent problématiques. «Le problème n’est pas tant la présence physique des plastiques que les produits chimiques qui s’en échappent et d’autres facteurs environnementaux, tels que les particules en suspension et les biofilms», explique Hoi Shing Lo. Pour illustrer ce phénomène, le projet a étudié la remise en suspension des sédiments, c’est-à-dire le remuement de la boue et du sable, un phénomène très fréquent lors des tempêtes, du dragage ou même du lavage des hélices de bateau. Lorsque ces particules fines remontent dans la colonne d’eau, elles transportent des nutriments et des contaminants qui, autrement, auraient été retenus. Dans le cadre de leurs expériences, menées à la fois sur le terrain et en laboratoire, les chercheurs ont constaté que l’ajout de microplastiques allongeait la durée de suspension et de la rendait plus dense. Sur cette base, les chercheurs ont conclu que les turbulences supplémentaires libéraient davantage de polluants liés aux sédiments, réduisaient la clarté de l’eau et créaient une impulsion chimique plus forte susceptible de stresser les algues. «En d’autres termes, les microplastiques augmentent non seulement la quantité de boue remise en suspension dans l’eau, mais amplifient également l’ensemble de la perturbation et ses conséquences écologiques», insiste Hoi Shing Lo.
Pourquoi, comment et où surveiller la pollution plastique?
Ces résultats sont importants car ils révèlent que l’impact de la pollution plastique doit être abordé dans le contexte d’environnements réels. «Il ne s’agit pas seulement de déchets visibles, les lixiviats chimiques et les biofilms peuvent interférer avec les processus écologiques fondamentaux, tels que la photosynthèse, le cycle des nutriments et la régulation de la croissance des algues», souligne Hoi Shing Lo. Les bancs d’algues, qui sont souvent des points chauds de la biodiversité, s’avèrent particulièrement vulnérables. Selon Hoi Shing Lo, cela signifie que les agences environnementales, les gestionnaires du littoral et tous ceux qui travaillent sur les habitats marins doivent repenser pourquoi, quand et comment surveiller la pollution plastique. «Les habitats végétaux ne sont pas seulement des points de concentration du plastique, ils peuvent aussi être des alliés critiques, offrant des services naturels qui aident à piéger, retenir et même décomposer les déchets plastiques», conclut Hoi Shing Lo. Les recherches menées dans le cadre de ce projet feront l’objet d’un article en couverture d’un prochain numéro de «ACS Environmental Au»(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Le projet SCRAP a été soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre).