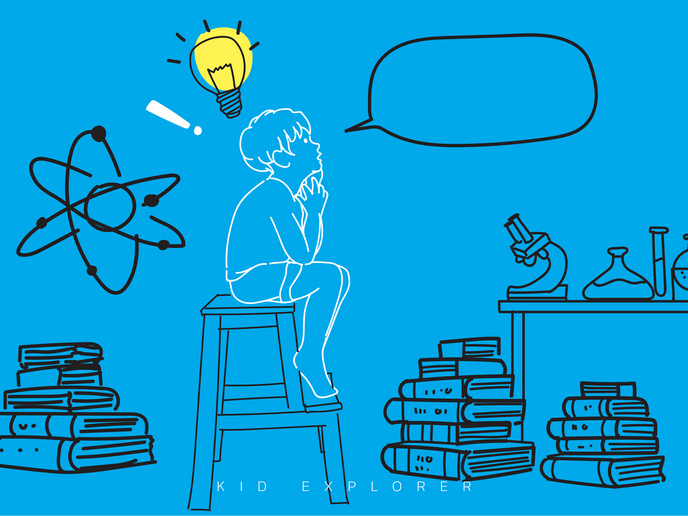Des recherches révèlent que privilégier les transitions agroécologiques constitue la clé d’un système alimentaire plus durable et plus juste.
Le changement climatique nous oblige à repenser la façon dont nous produisons et consommons la nourriture. «Nous devons évoluer des systèmes alimentaires actuels vers des systèmes plus équitables et résilients, qui privilégient les facteurs environnementaux, économiques et sociaux», explique Claire Lamine, sociologue à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (INRAE). Même si cette transition est plus facile à dire qu’à faire, c’est un défi que Claire Lamine, et l’écologiste Danièle Magda, se sont donné pour mission de relever à travers le projet ATTER(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE. «Il s’agit de transformations complexes qui impliquent des changements systémiques dans la façon dont nous produisons, consommons, transformons et distribuons les aliments, et leur mise en œuvre exigera une participation complète des parties prenantes, une innovation technologique et un soutien politique», explique Claire Lamine.
Utiliser l’agroécologie pour soutenir les systèmes alimentaires territoriaux
Le projet soutenu par le programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a développé des outils, des solutions et des connaissances destinés à faciliter et soutenir les transitions agroécologiques dans les systèmes alimentaires territoriaux. «Pour répondre aux objectifs de développement durable(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) et aux défis des transitions des systèmes alimentaires, l’agroécologie est désormais reconnue comme un modèle prometteur et l’échelle territoriale comme une échelle d’analyse et d’action appropriée», confie Claire Lamine. Bien que l’agroécologie réponde à de nombreuses définitions, ATTER la considère comme une approche globale de l’agriculture et des systèmes alimentaires durables. «Fondée sur les principes écologiques et sociaux développés à travers l’étude de l’agriculture paysanne et des modes d’alimentation régionaux, l’agroécologie privilégie le travail avec la nature et cherche à utiliser les processus naturels pour améliorer la biodiversité, la santé des sols et le rendement tout en favorisant l’équité entre les acteurs des systèmes alimentaires», précise Claire Lamine. Les systèmes alimentaires territoriaux sont des systèmes profondément ancrés dans des zones géographiques et culturelles spécifiques et incarnent une échelle où les réseaux alimentaires locaux peuvent être renforcés, les pratiques agroécologiques promues et la dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales réduite.
Des études de cas mettent en évidence une série de systèmes alimentaires territoriaux
Le projet a développé un portefeuille de 16 études de cas territoriales(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) avec des caractéristiques socio-agro-écologiques contrastées au Brésil, en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il s’agit de contextes ruraux et urbains, et de petites régions où les productions agricoles sont plus spécialisées ou plus diversifiées, les réseaux agroalimentaires et les initiatives de la société civile plus ou moins actifs, et les politiques publiques plus ou moins favorables. L’analyse des études de cas révèle comment et dans quelle mesure les chaînes d’approvisionnement alimentaire courtes, les achats publics durables de denrées alimentaires, les partenariats multipartites et les marchés alimentaires locaux peuvent favoriser la souveraineté alimentaire, améliorer la santé publique, réduire l’impact environnemental et autonomiser les petits exploitants agricoles.
Donner la priorité aux transitions agroécologiques
Sur la base de ces études de cas, le projet a fourni une analyse complète de la diversité des voies de transition et des mécanismes susceptibles de favoriser ou d’entraver les processus de transition. Il a également fourni des recommandations méthodologiques et politiques pour soutenir la dynamique de transition dans son contexte de manière inclusive et participative. «Nos travaux illustrent à quel point la réussite des transitions agroécologiques dans les systèmes alimentaires territoriaux dépend du contexte», explique Claire Lamine. Le projet a développé un observatoire partagé(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) où les parties prenantes peuvent consulter les analyses des études de cas. Il a également créé une série de sources de formation en ligne(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) que les chercheurs, les étudiants, les parties prenantes, les citoyens et les décideurs peuvent utiliser pour en savoir plus sur la transition agroécologique des systèmes agroalimentaires territoriaux. «Le projet ATTER a non seulement mis en lumière les raisons pour lesquelles nous devons privilégier les transitions agroécologiques, mais il a également développé une méthodologie originale pour réaliser ces transitions», conclut Claire Lamine. «Ce faisant, il a contribué à définir une voie durable vers la démocratie et la justice alimentaires.»