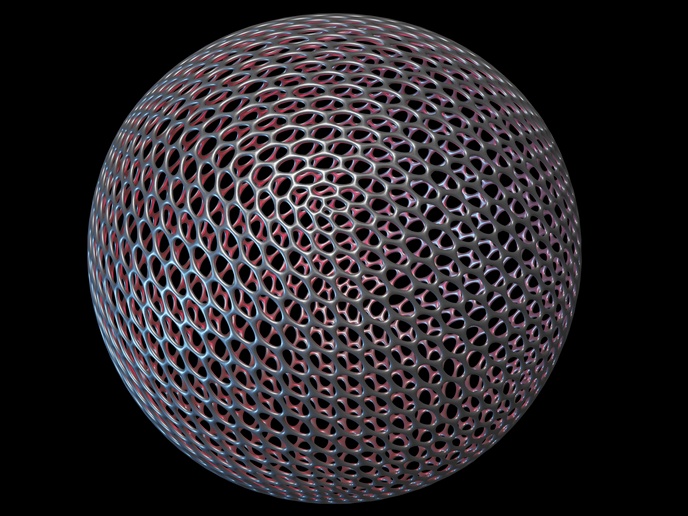Estimer les niveaux d’exposition humaine aux nanoplastiques
Les nanoplastiques, des morceaux ou particules de plastique extrêmement petits qui peuvent se retrouver dans l’environnement, sont devenus l’objet d’un grand nombre de recherches universitaires. La plupart de ces travaux se sont toutefois concentrés sur leur impact potentiel sur les écosystèmes plutôt que sur les risques qu’ils représentent pour la santé humaine. Le projet PLASTICHEAL(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), financé par l’UE, a été lancé pour remédier à cette lacune. «Nous avons entrepris de mieux comprendre ce qui nous arrive», explique la coordinatrice du projet PLASTICHEAL, Alba Hernández, de l’université autonome de Barcelone(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (UAB) en Espagne.
Techniques d’identification des nanoparticules chez l’humain
Le projet avait deux objectifs distincts. Le premier consistait à obtenir une image plus claire des niveaux d’exposition humaine aux nanoplastiques, une première étape essentielle pour appréhender l’ampleur du problème. Le second consistait à mieux comprendre les effets potentiels sur la santé liés à certains niveaux d’exposition. Alba Hernández fait remarquer que la prise en compte de la taille des nanoparticules est cruciale pour l’évaluation des niveaux d’exposition humaine. «Seuls les nanoplastiques les plus petits peuvent passer de l’air ou de la nourriture dans le corps et dans la circulation sanguine», explique-t-elle. «Ils peuvent ensuite se disséminer et s’accumuler dans les organes.» De nouvelles technologies ont été développée pour identifier ces nanoplastiques dans les aliments, les boissons et dans l’air, et pour les détecter dans le sang et dans l’urine. Les travailleurs de l’industrie du plastique ont été testés, car ils sont plus susceptibles d’avoir été exposés aux nanoplastiques. «Personne auparavant n’avait été en mesure de le faire pour des particules de plastique d’une taille inférieure à un micromètre», ajoute Alba Hernández. «Cela nous a permis de mieux comprendre les niveaux de concentration à l’intérieur du corps.»
Les effets potentiels des nanoplastiques dans l’organisme
Ensuite, l’équipe du projet a développé des outils in vitro pour examiner les effets potentiels des nanoplastiques dans l’organisme. «Nous voulions observer ce qui se passe lorsque les plastiques pénètrent dans les cellules, et si cela génère du stress, des modifications de l’ADN ou des réponses inflammatoires, etc.», explique Alba Hernández. «Nous voulions également savoir si nous pouvions prédire les effets à long terme, notamment la cancérogénicité, et évaluer tout changement du microbiome.» Le projet a développé pour ce faire des nanoparticules aussi représentatives que possible de celles que l’on trouve dans la nature. L’objectif était de garantir des résultats aussi précis que possible. «Nous avons recueilli des informations que nous considérons comme des motifs de préoccupation suffisants», souligne Alba Hernández. «Il nous reste cependant beaucoup à comprendre, et nous ne savons toujours pas quelles seraient les limites de sécurité.»
Développer et harmoniser les technologies analytiques
Le consortium prépare actuellement une nouvelle proposition pour poursuivre ce travail en s’appuyant sur les connaissances acquises et les technologies développées. «Nous en savons beaucoup plus aujourd’hui», confie Alba Hernández. Les prochaines étapes consisteront à poursuivre le développement et l’harmonisation des technologies analytiques. «Elles doivent être non seulement utilisables au sein de notre groupe de projet, mais également par l’ensemble de la communauté scientifique», ajoute Alba Hernández. «Nous devons discuter des différents protocoles avec les organismes de normalisation.» Le projet a mené un effort considérable pour impliquer l’industrie et les régulateurs, afin de s’assurer que les données recueillies soient aussi utiles que possible à la société. L’objectif final, conclut Alba Hernández, est de contribuer à une évaluation précise des risques et à la réglementation des limites de sécurité.