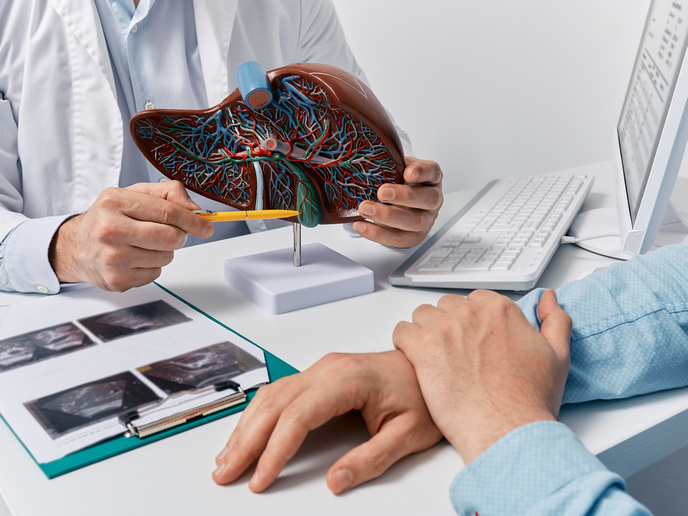Les secrets du thermostat de l’organisme pourraient être à l’origine d’innovations dans le domaine de la santé
Malgré une large gamme de températures, les mammifères peuvent maintenir leur température corporelle interne (Tcore) à environ 37 °C, l’aire préoptique hypothalamique du cerveau (POA) jouant un rôle clé. «Si l’on sait que certains processus d’équilibrage thermique nécessitent du carburant métabolique – pour frissonner ou activer la graisse brune, par exemple – la manière précise dont cela se produit, en particulier sur des périodes prolongées, reste mystérieuse», explique Jan-Erik Siemens(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) du projet Acclimatize, financé par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (CER). Pour faire la lumière sur cette question, le projet Acclimatize a bénéficié de l’identification récente par l’équipe du premier capteur moléculaire de température connu(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) au sein des neurones thermorégulateurs de la POA: un canal ionique thermosensible connu sous le nom de récepteur transitoire du potentiel de la mélastatine 2 – TRPM2(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre). Cette découverte a permis à l’équipe de mener des expériences de stimulation de la température POA in vivo sur des souris, afin d’explorer le fonctionnement des neurones thermorégulateurs, en utilisant TRPM2 comme marqueur moléculaire. «En plus de montrer comment un groupe spécifique de cellules cérébrales réagit à la chaleur, nos découvertes sur les fluctuations de température des structures cérébrales profondes ont de vastes implications pour la recherche», note Jan-Erik Siemens de la Faculté de médecine de l’Université de Heidelberg(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), qui héberge le projet.
De l’homéostasie thermique aiguë à l’acclimatation thermique à long terme
Acclimatize s’intéresse moins aux processus mieux compris de régulation de la température corporelle à court terme qu’à la manière dont les mammifères le font à plus long terme. «La plupart des mammifères peuvent s’adapter aux changements de température sur de longues périodes, généralement des semaines ou des mois. Il suffit de penser à la façon dont nous nous habituons à l’augmentation des températures pendant l’été», ajoute Jan-Erik Siemens. On savait, par exemple, que les souris perdaient de la graisse brune, leur principal organe de chauffage, lorsqu’elles s’adaptaient à des températures plus chaudes, d’où les questions suivantes: ce phénomène est-il orchestré par le système nerveux et, dans l’affirmative, comment? Pour étudier la question, l’équipe a visualisé certains neurones dans la POA, puis a laissé des souris en incubateur s’acclimater à des températures plus chaudes, avant d’utiliser des techniques de neurophysiologie pour rechercher la plasticité synaptique, mais n’a trouvé que peu d’éléments probants. «Mais nous avons trouvé une activité significativement plus importante dans ces neurones thermorégulateurs, augmentant avec le temps. Il est surprenant de constater que, bien qu’elles soient situées au plus profond du cerveau, elles semblent suivre la température du corps. L’une des hypothèses est que le flux sanguin dans le cerveau atteint d’abord la POA, lui apportant de la chaleur», explique Jan-Erik Siemens. Grâce à cette découverte, l’équipe a trouvé pour la première fois, une molécule clé de l’acclimatation à la chaleur(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), composée de canaux ioniques NaV1.3 essentiels à l’augmentation de l’activité neuronale, qui semble préparer les organes périphériques à la chaleur.
Implications pour la science biomédicale
Le projet Acclimatize a permis d’explorer plus avant les liens entre le mécanisme d’acclimatation et le métabolisme énergétique, en mettant l’accent sur l’obésité. «Les recherches se poursuivent et nous ne pouvons pas encore tirer de conclusions définitives, mais il semble probable que l’acclimatation à la chaleur puisse contrecarrer certaines formes d’obésité, du moins chez les souris», explique Jan-Erik Siemens. Selon Jan-Erik Siemens, cette découverte, si elle est corroborée, pourrait conduire à deux voies thérapeutiques possibles. Premièrement, la chaleur générée par des ultrasons focalisés, par exemple pour atteindre le cerveau en profondeur, pourrait être exploitée pour moduler l’activité neuronale de la POA, imitant ainsi les avantages de l’acclimatation à la chaleur pour la santé dans le cas de l’obésité. Deuxièmement, un médicament pourrait être développé en utilisant la capsaïcine(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) (le composant piquant des piments) pour activer les récepteurs de chaleur périphériques, leurs signaux remontant jusqu’à la POA pour déclencher les neurones d’acclimatation à la chaleur. En outre, inspirée par le projet Acclimatize, Jan-Erik Siemens étudie actuellement comment le processus d’acclimatation à la chaleur pourrait aider les personnes présentant un risque cardiovasculaire, pendant les vagues de chaleur par exemple. «La question de savoir comment nous pouvons imiter cliniquement les avantages de l’acclimatation à la chaleur est un nouveau domaine très intéressant qui découle de cette subvention du CER», conclut Jan-Erik Siemens.