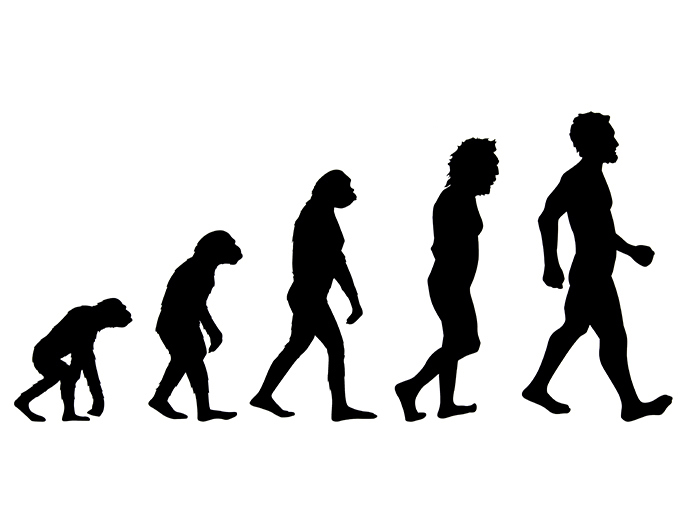Les voyages secrets des collections de musées
Les musées scientifiques du monde entier sont confrontés à des demandes croissantes en matière de provenance (l’historique de la propriété des objets) et de questions de rapatriement. Il est complexe de comprendre d’où viennent les collections, comment elles ont été déplacées et pourquoi elles se sont retrouvées dans des institutions spécifiques. Le projet SciCoMove(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a apporté un nouvel éclairage sur ces questions, en étudiant des collections scientifiques de 1800 à 1950 en paléontologie, anthropologie, botanique et sciences appliquées connexes. Réalisé avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), le projet a réévalué le rôle des musées dans la préservation et l’interprétation des objets historiques. «La provenance est une question complexe. Toutes les situations de collecte n’étaient pas clairement illégales et/ou coloniales. Les personnes impliquées dans la collecte et le transport des objets vers les musées étaient nombreuses et agissaient selon des motivations diverses», explique Nathalie Richard, coordinatrice scientifique de SciCoMove.
Petits musées, grands enjeux
Alors que les débats sur la provenance se concentrent souvent sur les grandes institutions bien connues, SciCoMove a porté son attention sur les petits musées, découvrant ainsi une géographie plus nuancée des déplacements de collections scientifiques. Cet axe a mis en évidence les différentes manières dont les musées ont fonctionné au fil du temps. «Au-delà de leur définition actuelle d’institutions permanentes chargées de la conservation des collections, nos recherches ont également révélé leur précarité. De nombreux musées scientifiques ont été créés, mais beaucoup ont disparu. À l’intérieur, des objets, des collections et des informations ont également disparu.» Grâce à la collaboration entre des universitaires et des experts d’Amérique latine et d’Europe, SciCoMove a cherché à établir une histoire fondée sur des contributions égales. Cela montre que les collections scientifiques ont circulé dans plusieurs directions: «non seulement de l’Amérique latine vers les principaux musées des capitales occidentales, mais aussi entre les musées des pays dits du Sud, et d’un petit musée à un autre», note Nathalie Richard. L’équipe a également documenté des collections se déplaçant dans la direction opposée: de l’Europe vers l’Amérique latine.
Suivre les objets à travers le temps
Bien que l’analyse des objets de musée et de leurs archives se soit révélée difficile, les documents étant fragmentés et dispersés, le projet a permis de reconstituer la manière dont les collections circulaient au fil du temps. En se penchant sur les archives des musées, SciCoMove a organisé des ateliers afin d’examiner les aspects pratiques de la collecte. Ces événements ont couvert différents domaines, de la pharmacie et de l’agriculture à l’économie des objets rares ou recherchés, étudiant comment ceux-ci ont donné lieu à des contrefaçons et des reproductions. L’équipe a également étudié la manière dont les réseaux professionnels, religieux et linguistiques, ainsi que les diasporas de migrants, ont influencé le flux des collections. En suivant ces mouvements, le projet a redéfini les musées comme des «nœuds dynamiques dans les réseaux de connaissances» plutôt que comme des entrepôts statiques. «Les musées sont des lieux qui rassemblent des personnes et des objets, où l’interprétation scientifique et les principes de classification des collections sont co-construits», définit Nathalie Richard. En revanche, la recherche a montré que les musées pouvaient également être considérés comme des lieux de dispersion, car les objets sortent par le biais de ventes et d’échanges, parfois involontairement ou même par des moyens frauduleux. Les études de cas(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) de SciCoMove illustrent ces mouvements complexes. Le tatou en est un exemple, représenté dans de nombreuses institutions partenaires du projet. Son parcours reflète son statut symbolique d’emblème des Amériques, sa place changeante dans les classifications scientifiques et sa valeur commerciale: les pressions exercées sur les collections mettant parfois même l’espèce en danger. Des récits sur les spécimens de tatous et d’autres objets provenant des collections partenaires peuvent être consultés dans l’exposition numérique(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) du projet. La recherche a également permis de promouvoir de meilleures pratiques de conservation, en aidant les institutions à redécouvrir d’anciennes étiquettes pour comprendre les traces du passé.