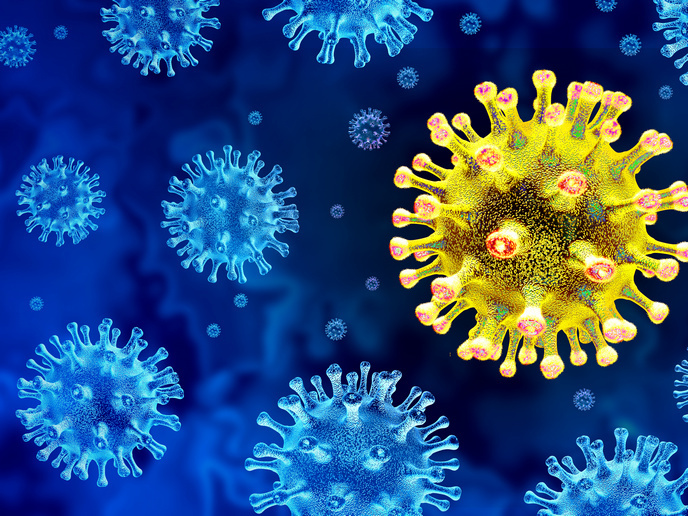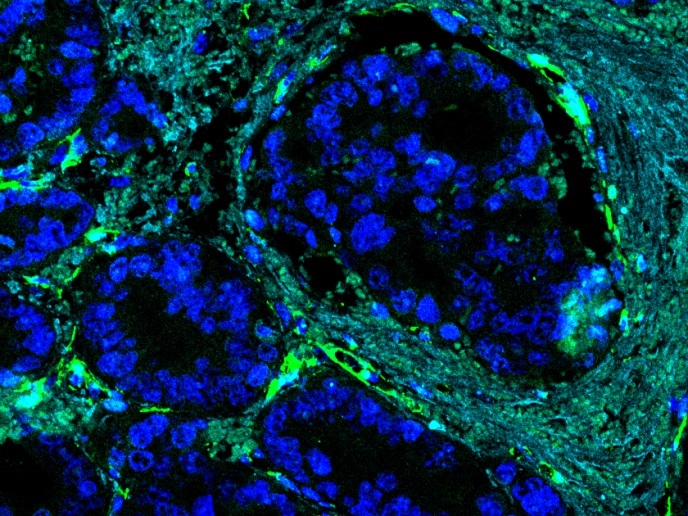L’exposition du père à des produits chimiques peut avoir un impact sur la santé de son enfant
Alors que l’effet du mode de vie maternel et des expositions in utero est bien étudié, l’héritage épigénétique paternel a été largement ignoré. De nouvelles recherches menées dans le cadre du projet PATER, financé par l’UE, suggèrent toutefois que l’environnement du père peut aussi avoir un impact significatif sur la santé de l’enfant. «Lorsqu’un spermatozoïde féconde un ovule, non seulement l’ADN est transmis, mais les effets que l’exposition à divers facteurs environnementaux (tels que les produits chimiques, le stress et les choix de vie) peut avoir engendrés sont également transmis aux générations suivantes», explique Oskar Karlsson, responsable de recherche au SciLifeLab, au département des sciences de l’environnement, de l’université de Stockholm(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre), partenaire coordinateur du projet. Ce constat est particulièrement préoccupant compte tenu de l’augmentation spectaculaire de l’utilisation des produits chimiques ces dernières années. C’est pourquoi le projet PATER s’est spécifiquement concentré sur la façon dont, par le biais de l’héritage épigénétique, l’exposition d’un père à des polluants anti-androgènes peut affecter la santé de sa progéniture. Les polluants anti-androgènes sont des substances chimiques présentes dans l’environnement qui interfèrent avec les hormones sexuelles mâles de l’organisme en bloquant le récepteur des androgènes. L’héritage épigénétique est le mécanisme par lequel des caractères acquis, influencés par des facteurs environnementaux, peuvent être transmis de génération en génération sans modifier la séquence d’ADN sous-jacente.
Des preuves concrètes de l’héritage épigénétique paternel
Recourant à la fois à des grenouilles et à des souris, le projet soutenu par le Conseil européen de la recherche(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) a employé une combinaison d’approches, notamment des tests moléculaires, toxicologiques et épigénomiques. Les chercheurs ont découvert des preuves concrètes de l’héritage épigénétique paternel chez les vertébrés. «Nos recherches démontrent que l’exposition du père à des produits chimiques peut effectivement altérer les marques épigénétiques des spermatozoïdes, induisant des effets sur la santé de la descendance et même des petits-enfants», explique Oskar Karlsson. Chez les grenouilles, des chercheurs ont démontré que l’exposition aux pesticides pouvait réduire la fertilité et altérer le métabolisme sur plusieurs générations. Chez les souris, ils ont mis en évidence la manière dont l’exposition à un plastifiant courant provoque un dysfonctionnement métabolique et immunitaire qui persiste chez la descendance non exposée. Le projet a également permis de découvrir certains des mécanismes moléculaires à l’origine de ces effets, tels que des modifications des biomolécules du sperme, qui établissent un lien entre l’exposition paternelle et les conséquences héréditaires sur la descendance.
Faire progresser la science, l’égalité des sexes et l’équité sociale
Selon Oskar Karlsson, ces résultats contribuent à éclairer et à remodeler les discussions sur la santé reproductive parmi les scientifiques et les décideurs politiques. «En mettant l’accent sur les conséquences à long terme que l’exposition du père peut avoir sur la santé de sa progéniture, ce projet remet en question le discours traditionnel selon lequel seules les mères sont responsables de la santé de l’enfant», ajoute-t-il. «Ce faisant, PATER a non seulement contribué à la science, mais aussi à promouvoir l’égalité des sexes et l’équité sociale.» Soulignant la nécessité de tests de toxicité multigénérationnels et de sensibilisation à la santé préconceptionnelle masculine, le projet soutient également les objectifs de l’UE en matière de santé publique, de sécurité chimique et de protection de l’environnement. Par exemple, l’un des principaux succès du projet a été son fort engagement auprès du public et des décideurs politiques, un engagement qui a permis de traduire des résultats scientifiques complexes en messages accessibles sur la façon dont l’environnement d’un père peut avoir un impact direct sur la santé et le bien-être de ses enfants et petits-enfants. «Nous espérons que ce dialogue continuera d’inspirer à la fois la prise de conscience et l’action, favorisant des discussions plus équitables sur la santé reproductive et une protection renforcée contre les polluants environnementaux nocifs», conclut Oskar Karlsson. Bien que PATER ait toujours partagé ouvertement ses résultats avant même leur publication afin d’accélérer les progrès dans ce domaine émergent, l’équipe de recherche finalise actuellement plusieurs publications à fort impact basées sur les dernières données du projet.